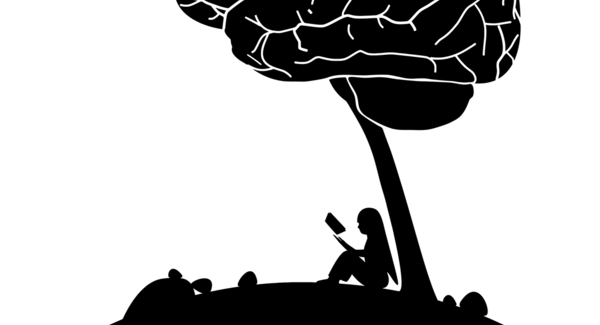Notre cerveau en proie au doute
Publié par Marie-Catherine Mérat, le 30 avril 2018 18k
Pourquoi doutons-nous ? Ce sentiment est-il ancré au plus profond de nous ? S’il n’est pas excessif, le doute est loin d’être néfaste. Au contraire, il est au centre de la majorité de nos décisions.
Sûr de vous, vous marchez d’un bon pas. Cette rue, vous la connaissez, vous l’avez déjà empruntée. Votre rendez-vous est dans dix minutes, rien ne presse. Une petite boutique attire soudain votre regard. C’est curieux, cette devanture ne vous dit rien du tout. Pas plus que cette boulangerie située à quelques mètres. Pourtant, il s’agit bien de la bonne rue… Tout à coup, vous n’en êtes plus aussi certain. Confus, vous persévérez encore quelques mètres, avant de stopper net, complètement perdu, submergé par le doute.
Ce moment, où le stress succède à la décontraction, où la certitude la plus absolue fait place à l’hésitation la plus totale, vous le connaissez, vous l’avez déjà vécu. Est-il sentiment plus humain que celui de douter ? Nous doutons tous, tout le temps. Lorsque nous nous demandons si nous avons bien fermé la porte de la maison et nous empressons d’aller vérifier ; quand en voiture, arrivés à un croisement, nous hésitons sur la direction à prendre ; ou lorsqu’après avoir accepté un nouveau poste, nous ne sommes plus aussi sûrs d’avoir pris la bonne décision. « À partir du moment où nous l’expérimentons, cela signifie que le doute existe, il a une réalité. Et cette réalité se passe forcément dans notre cerveau ! », s’amuse Karim N’Diaye, neuroscientifique à l’Institut du Cerveau et de la moëlle épinière à Paris. Cette évidence énoncée, explorer les bases cérébrales du doute nous confronte néanmoins à une bonne dose d’incertitude. Que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque nous doutons ? Comment naît ce sentiment si familier et comment nous en accommodons-nous au quotidien ?
Oui, non, je ne sais pas
« En neurobiologie, on ne parle pas vraiment de doute, on parle plutôt d’incertitude, clarifie Frédéric Stoll, post-doctorant au Rudebeck lab, à New York. Mais les deux sont liés. Le doute est un sentiment d’incertitude, quelque chose de désagréable, qui apparaît dès que l’on ne sait pas quoi faire, quelle action prendre ou même quoi penser d’une situation donnée. » Comment émerge-t-il ? En premier lieu lorsque nous manquons d’informations, que nous n’avons pas toutes les clés en main pour prendre une décision éclairée. Si vous vous retrouvez dans le métro londonien sans parler un mot d’anglais par exemple, vous risquez fort d’hésiter sur la direction à prendre ! « L’incertitude fait partie du monde qui nous entoure, observe Karim N’Diaye. La question est de savoir quels systèmes cérébraux la computent. »
Pour l’explorer expérimentalement, rien de plus simple a priori. Il suffit de manipuler la quantité d’informations que l’on délivre aux sujets – en leur montrant plus ou moins rapidement deux photographies de visages par exemple – puis de leur demander d’effectuer une tâche simple – dire si oui ou non les deux visages sont identiques – et d’évaluer simultanément le degré de certitude qu’ils accordent à leur réponse – en sont-ils sûrs ? « Il n’est pas évident de savoir comment émerge le doute. Ce que l’on peut faire, c’est mettre des hommes, des femmes, en situation d’incertitude et regarder ce qu’il se passe dans leur cerveau », décrit Luc Mallet, responsable de l'équipe « Comportement, émotion et ganglions de la base » à l’Institut du cerveau et de la moelle épinière. Or il s’avère que le cortex préfrontal joue un rôle fondamental dans la confiance que l’on accorde à ses décisions, dans le sentiment d’être ou non sûr de soi.
L’épicentre du doute
En 2010, Elisabeth Rounis et ses collaborateurs, du University College London, l’ont mis en évidence de façon pour le moins radicale chez vingt volontaires. L’étude consistait à occasionner, chez un premier groupe de sujets, une lésion virtuelle dans une région précise de leur cortex préfrontal, le cortex préfrontal dorsolatéral, en appliquant, à l’extérieur de leur crâne, un champ magnétique perturbant temporairement l’activité cérébrale, une technique connue sous le nom de stimulation magnétique transcrânienne (SMT). Un deuxième groupe recevait une SMT factice. Puis l’équipe présentait à tous les sujets une image, de façon très brève, et leur demandait de déterminer s’il s’agissait d’un carré ou d’un losange. Simultanément, les volontaires devaient juger si l’image leur était apparue claire ou non, en somme dire s’ils étaient sûrs ou non de leur réponse. Résultat : alors que l’ensemble des volontaires affichaient les mêmes performances de reconnaissance d’image, seuls les sujets dont l’activité cérébrale avait été altérée par la SMT avaient des difficultés à émettre un jugement, à exprimer le niveau de confiance qu’ils accordaient à leur réponse. Comme s’ils n’étaient plus capables de ressentir de certitude ou d’incertitude. Un doute encore plus profond – ne même plus savoir si l’on est sûr ou pas sûr – semblait s’être emparé de leur esprit !
Le cortex préfrontal, épicentre du doute ? Cela n’aurait rien de très étonnant, il est un peu le chef d’orchestre du cerveau. On sait aujourd’hui qu’il joue un rôle crucial dans la prise de décision, mais aussi l’évaluation des performances ou encore la recherche d’informations, autant de processus cognitifs étroitement liés au doute. « Quand nous sommes dans un contexte d’incertitude[Que faire ? Où aller ?], la seule issue est d’aller vérifier, rechercher de l’information, pour prendre la meilleure décision possible. Nous faisons cela en permanence », détaille Frédéric Stoll. Loin d’être néfaste, l’incertitude jouerait ainsi un rôle moteur dans l’adaptation des comportements. « Si je doute de mes connaissances, si je juge que ne maitrise pas une partie de mes travaux par exemple, je vais décider de passer plus de temps dessus avant de passer à la suite. L’incertitude apparaît ainsi omniprésente, au centre de la majorité de nos décisions ». Reste à savoir comme elle est traitée dans notre cerveau et surtout, comment elle donne naissance à ce sentiment si partagé qu’est le doute.
Le propre de l’homme ?
Aussi paradoxal que cela paraisse, ce sont les études menées chez l’animal qui nous fournissent les données les plus fines sur cette question. Étudier le doute chez l’animal ? Drôle d’idée a priori. Ce sentiment n’est-il pas le propre de l’homme ? Tout dépend ce que l’on entend par doute. Beaucoup d’animaux – singes, souris, dauphins…–, placés en situation d’incertitude, affichent un comportement que nous sommes tentés, de manière anthropomorphique, d’assimiler au doute. C’est notamment le cas des dauphins, qui se mettent à nager plus lentement et à secouer la tête ! Ou des singes, qui manifestent bruyamment leur inconfort lorsqu’ils n’ont pas toutes les informations nécessaires pour réaliser la tâche qui leur est demandée. Ces animaux ont-ils conscience de leur état ? Savent-ils qu’ils ne savent pas ? Sur cette question, les débats scientifiques sont loin d’être tranchés. Une chose est sûre, leur cerveau traite l’incertitude liée à l’environnement (« Quel est ce bruit ? Un prédateur en approche ? »). Il est donc possible d’aller y voir de plus près, en y implantant quelques électrodes.
C’est précisément ce qu’ont fait en 2008 Adam Kepecs et ses collaborateurs, du Cold Spring Harbor Laboratory à New York avec… des rats. Et ce qu’ont observé ces scientifiques est étonnant : dans le cortex préfrontal des rongeurs, certains neurones reflètent directement leur état d’incertitude !
Dans cette étude, un rat fait face à trois dispositifs. À gauche, l’un renferme une odeur A, à droite un autre renferme une odeur B et au centre, un troisième contient une odeur C, fruit d’un mélange variable des effluves A et B. La tâche que doit réaliser le rongeur est simple : introduire son museau dans le dispositif central et décider si l’effluve reniflée correspond plutôt à l’odeur A ou à l’odeur B en se dirigeant vers l’un ou l’autre des dispositifs ad hoc. En cas de réponse juste, l’animal reçoit une récompense. Rien en cas d’erreur. Parallèlement, les scientifiques enregistrent, à l’aide d’électrodes implantées dans son cerveau, l’activité de neurones du cortex orbitofrontal, une région située à l’avant du cortex préfrontal. Les résultats sont nets : certains neurones ont un taux de décharge faible lorsque la tâche est facile – l’odeur C est composée de 100% de A et 0% de B par exemple – et élevé quand la tâche est difficile et que le rat hésite – l’odeur C est composée de 50% de A et 50% de B.
Plus étonnant, dans une deuxième expérience, les expérimentateurs donnent au rongeur la possibilité de redémarrer tout de suite un nouvel essai, avant même de connaître l’issue de sa performance sur l’essai précédent, donc avant même de savoir s’il recevra ou non une récompense. Et ce que les scientifiques constatent, c’est que le rat décide plus souvent de retenter sa chance lorsque la tâche est difficile et que ses neurones « du doute » déchargent fortement. Comme s’il savait qu’il ne connaissait pas la bonne réponse. «D’une manière anthropomorphique, on serait tenté de dire qu’il sait qu’il ne sait pas », avance Karim N’Diaye.
Rien n’est moins sûr. Ce qui semble clair en revanche, c’est que certains neurones du cortex préfrontal codent l’état d’incertitude que ressent l’animal, consciemment ou non.
Biais de jugement
Reste que le doute ne se réduit pas à une incertitude sur l’environnement ! Nous ne doutons pas seulement lorsque, plissant les yeux, nous peinons à déchiffrer un écriteau situé à quelques mètres. Nous doutons aussi parfois de nos performances sans que ce manque de confiance soit pleinement justifié. En marchant dans la rue, vous reconnaissez un ami au volant d’une voiture. Est-ce bien lui ? Peut-être pas, car vous vous savez piètre physionomiste. Nous sommes ainsi très forts pour moduler notre jugement. « Parfois, le sujet rajoute des biais sur l’information qu’il a mémorisée, sur ce qu’il vient de faire. Ce qui crée une dissociation entre le doute initial issu de l’environnement et le doute effectivement ressenti », explique Emmanuel Procyk, directeur de recherche à l’Institut Cellule souche et cerveau, à Bron. Car le doute renvoie à la notion de métacognition, un processus cognitif de haut niveau que l’on pourrait définir comme la cognition sur la cognition, la capacité de juger ses propres performances et décisions (« Ai-je bien répondu ? Ai-je bien agi ? »). Une forme d’introspection en somme.
Or il se trouve que nos capacités d’introspection sont limitées. Notre sentiment de savoir ou de ne pas savoir, d’être sûrs ou pas sûrs, n’est pas toujours très fidèle à nos actes. Combien d’étudiants sortent d’un examen, persuadés d’avoir échoué, et ont finalement la surprise d’obtenir des résultats parfaitement louables (et vice versa) ? Nous sommes ainsi de piètres juges de nos performances. Au quotidien, nous aurions plutôt tendance à être un peu trop sûrs de nous, à écarter tout sentiment de doute rétrospectif (« Ai-je bien agi ? »), vécu comme désagréable. « Nous avons toujours l’impression, quelque part, que nous avons pris la bonne décision, observe Karim N’Diaye. C’est adaptatif ! Mieux vaut être persuadé d’avoir fait le bon choix que vivre avec l’idée de s’être trompé ».
Dans les années 1990, Asher Koriat, spécialiste de métacognition à l’Université d’Haïfa en Israël, a magistralement mis en évidence cette discordance entre confiance dans ses performances et performances réelles.
Le psychologue a en effet demandé à plusieurs sujets de mémoriser quatre consonnes, avant de les distraire sur une tout autre tâche pendant une vingtaine de secondes. À l’issue de cette première phase de l’expérience, il leur a demandé de rapporter le maximum de lettres dont ils croyaient se souvenir, puis d’exprimer leur sentiment de savoir : sauraient-ils reconnaître cette chaîne de caractères parmi d’autres ? Enfin, il a mesuré leurs performances réelles en leur présentant cette suite de consonnes parmi huit possibles. Les résultats de l’étude sont pour le moins déroutants : comme attendu, plus les sujets rapportent un grand nombre de lettres, plus leur sentiment de savoir est fort, donc moins ils doutent. Rien que de très logique. Sauf que les lettres rapportées ne sont pas toujours justes ! Plus ils rapportent de consonnes fausses en plus des consonnes correctes, et plus leur confiance grandit également ! Comme si le simple fait de rapporter de nombreux éléments de souvenirs, qu’ils soient ou non justes, suffisait à nourrir le sentiment de savoir et finalement, à réduire le doute.
Or non seulement nos capacités d’introspection sont limitées, comme en atteste cette étude, mais nous ne sommes pas tous aussi doués pour plonger en nous-mêmes. « Certaines personnes sont meilleures que d’autres pour évaluer leur degré d’incertitude », confirme Karim N’Diaye. En scannant le cerveau d’une trentaine de sujets, Stephen Fleming et ses collaborateurs, au University Collège de Londres, ont même montré en 2010 que les individus présentant les meilleures compétences métacognitives, capables d’évaluer leurs performances (« êtes-vous sûr de votre réponse ? ») avec le plus de justesse, sont aussi ceux qui présentent le plus de matière grise dans la partie antérieure du cortex préfrontal. Une corrélation étonnante, que les scientifiques sont pour l’heure bien en peine d’interpréter.
La folie du doute
Le doute révèle peu à peu sa double nature. Positive lorsqu’il motive des comportements d’exploration, de recherche d’information. Plus négative voire néfaste, lorsqu’il est exacerbé et révèle une altération du jugement. D’où vient que l’on doute trop, de ses performances, de soi, de ses actions quotidiennes ? Une pathologie, qualifiée au 19esiècle de « folie du doute » nous éclaire, précisément, sur ces questions. 2% de la population vit en effet avec un doute exacerbé, récurrent, invalidant. Ces milliers de personnes sont atteintes d’un trouble obsessionnel compulsif (TOC), caractérisé par des obsessions et des comportements répétitifs. L’un des symptômes majeurs du TOC, qui survient dans plus de 60% des cas, est le rituel de vérification. Habité d’un doute permanent, le sujet vérifie et revérifie des dizaines de fois que le four est bien éteint, la voiture bien fermée, etc. « Même dans les TOC qui n’ont pas de phénomène de vérification au premier plan, le doute est en fait central. Quand on demande à un laveur[patient qui se lave les mains de façon compulsive par peur des contaminations, ndlr] pourquoi il se lave les mains douze fois de suite, on comprend qu’en réalité, c’est parce qu’il n’est pas certain d’avoir bien fait ses lavages », observe Luc Mallet.
Que se passe-t-il dans le cerveau des sujets qui en sont atteints ? Une région notamment, apparaît suractivée, le cortex cingulaire antérieur dorsal, situé, là encore, dans le cortex préfrontal. L’un des traitements des TOC aux États-Unis consiste d’ailleurs à léser cette structure, une procédure au doux nom de cingulotomie.« Sauf que le cortex cingulaire est très important dans beaucoup de processus : l’évaluation des performances, la prise de décision, tout ce qui est motivationnel… donc le détruire n’est pas vraiment une solution », note Frédéric Stoll. D’autant qu’on est encore loin de connaître son rôle exact dans le TOC. L’une des hypothèses avancées ? En raison de son altération, les sujets ne parviendraient plus à évaluer correctement leurs performances, leur niveau de confiance dans leurs actions. Ce moment où l’on se demande « Suis-je certain d’avoir bien éteint la lumière ? ». Leur cerveau enverrait un signal d’erreur, les poussant à aller constamment vérifier, sans que jamais cette vérification n’apaise leur angoisse.
« Existe-t-il un continuum entre le doute pathologique et le doute normal dont chacun fait l’expérience ?s’interroge Karim N’Diaye. Le TOC est-il une forme aggravée du doute ? Ou ces patients ont-ils le même degré d’incertitude qu’un individu lambda, mais sans parvenir à le gérer de la même façon ? » Des interrogations qui sont autant de questions de recherche, et dont les réponses permettront peut-être, un jour, d’éclaircir le doute.